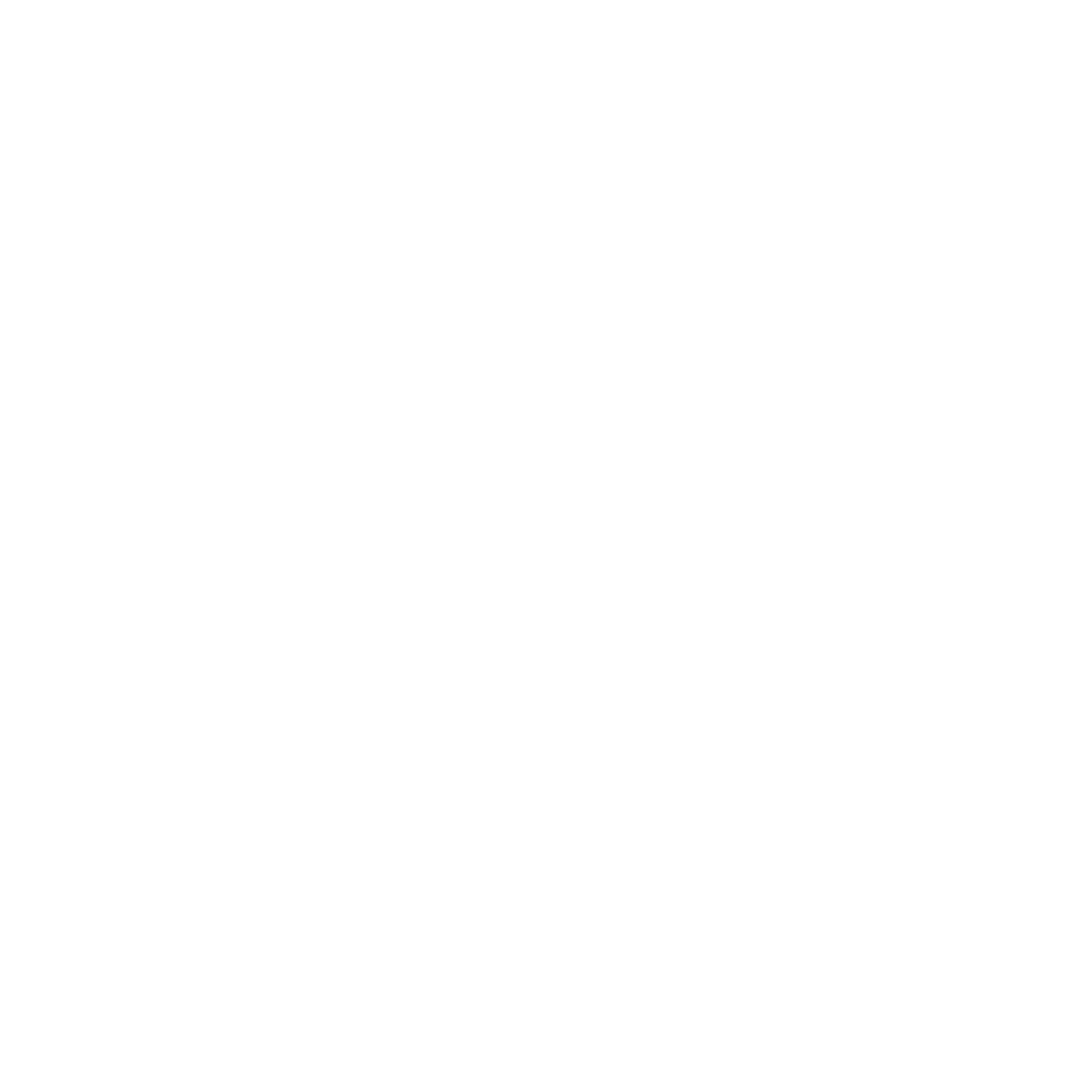Lien de causalité en dommage corporel : comprendre et agir
I/ Le lien de causalité : une condition essentielle à l’indemnisation du dommage corporel
Un principe fondamental du droit de la responsabilité
En droit français, la réparation d’un dommage corporel suppose un lien direct entre le fait générateur et le préjudice. Ce principe s’applique aussi bien en droit commun (article 1240 du Code civil) qu’aux régimes spéciaux, comme celui des produits défectueux (article 1245-8), où la victime doit prouver le dommage, le défaut, et le lien de causalité.
La jurisprudence accepte des présomptions graves, précises et concordantes pour établir ce lien (Cass. civ. 1re, 18 octobre 2017). La directive européenne du 23 octobre 2024 (n° 2024/2853) va plus loin, en instaurant une présomption simple de causalité dans certains cas.
En matière médicale : une exigence stricte
La responsabilité médicale exige une faute prouvée ayant causé le dommage (article L.1142-1, I CSP). En l’absence de faute, une indemnisation au titre de la solidarité nationale est possible (L.1142-1, II CSP), à condition que le dommage soit directement causé par l’acte médical et qu’il soit grave et inhabituel.
À noter : un échec thérapeutique ou un aléa (ex. implant mal intégré malgré les règles de l’art) n’engage pas la responsabilité (Cass. civ. 1re, 30 novembre 2016).
Pathologies préexistantes : une preuve à la charge de la victime
Si le patient présente une affection latente, il doit prouver que les soins l’ont déclenchée ou aggravée. À défaut, seule une indemnisation partielle peut être admise au titre de la perte de chance (CE, 27 octobre 2000).
Ce que les juges exigent
Les juridictions exigent un lien certain et direct entre la faute et le dommage. En cas d’incertitude, l’indemnisation intégrale est exclue. La victime pourra seulement prétendre à une réparation pour perte de chance (CE, 18 mars 2020).
Les deux qualités du lien de causalité
Pour être indemnisé, le lien de causalité doit être :
- Direct : sans rupture entre le fait et le dommage ;
- Certain : exempt de doute sérieux sur son influence.
II/ Le lien de causalité : caractère direct et exigence de certitude
Le lien de causalité direct : un enchaînement logique
Le lien de causalité en droit du dommage corporel doit être direct : le préjudice doit découler immédiatement ou nécessairement du fait dommageable, sans intervention d’un élément étranger. Le Conseil d’État l’a rappelé dans un arrêt du 2 janvier 2024, en écartant la responsabilité d’une sage-femme dès lors que l’acte reproché n’aurait pas permis d’éviter la lésion. À l’inverse, la Cour de cassation (28 février 2024) a retenu la carence organisationnelle d’un service hospitalier comme cause directe d’une perte de chance.
🔎 La causalité directe n’exclut pas la pluralité de causes : plusieurs événements peuvent concourir au dommage. Le juge reconstitue alors la chaîne des faits selon deux grandes théories.
Deux approches jurisprudentielles : adéquation vs équivalence
- La causalité adéquate retient la cause principale du dommage. Elle est souvent mobilisée en droit administratif, notamment pour pondérer les responsabilités (CE, Marais, 1966 ; CE, Madranges, 2010).
- L’équivalence des conditions, plus favorable aux victimes, reconnaît toutes les causes ayant contribué au dommage, à condition que la chaîne ne soit pas rompue. Elle est régulièrement admise en matière médicale, comme dans l’affaire du Médiator (Cass. 2023), où la prise du médicament a suffi à établir un lien causal partiel.
Le juge administratif applique aussi cette équivalence dans les enchaînements complexes (ex. chute → fracture → opération → infection : CE, 20 décembre 2018).
L’exigence de certitude pour une réparation intégrale
Une réparation intégrale n’est possible que si la certitude du lien causal est démontrée. Si le lien reste incertain, l’indemnisation ne peut être accordée. Les juridictions rappellent qu’un simple enchaînement chronologique ne suffit pas (Cass. 4 février 2003 ; CE, 1982).
La perte de chance : un mode de réparation autonome
Lorsqu’il est plausible que la faute ait réduit les chances d’éviter le dommage, les juges reconnaissent une perte de chance, permettant une indemnisation partielle et proportionnée :
- Elle doit être réelle, sérieuse et mesurable.
- Elle peut découler d’une faute de soins, mais aussi d’un manquement au devoir d’information (Cass. 1990 ; CE, Consorts T., 2000 ; CAA Paris, Dépakine, 2025).
- Elle s’applique même en cas d’intervention fautive à plusieurs mains, chaque professionnel restant responsable in solidum.
🔚 En résumé
Le lien de causalité doit être à la fois direct et certain. À défaut, seule une perte de chance peut fonder l’indemnisation, dès lors qu’une faute avérée a privé la victime d’une issue plus favorable. Cette modulation permet de concilier équité pour la victime et sécurité juridique pour les responsables.
III / Causalité matérielle et causalité juridique : une distinction essentielle en droit du dommage corporel
Deux niveaux d’analyse pour une même réalité
Le droit distingue la causalité matérielle, qui désigne l’origine factuelle du dommage, de la causalité juridique, qui permet d’identifier la responsabilité de l’auteur. Cette seconde approche, plus normative, est centrale en matière d’indemnisation.
🔎 Exemple : Dans l’affaire Parcelier c. Teyssier (Cass. 1942), une opération réalisée sans consentement a entraîné une infection. Même si l’acte était techniquement maîtrisé, le défaut de consentement fonde juridiquement la responsabilité.
La causalité juridique : au-delà de la science
Le juge n’indemnise pas seulement en fonction de l’événement déclencheur, mais aussi selon sa valeur normative. L’arrêt Perruche (Cass. Ass. plén., 2000) en est emblématique : ce n’est pas la maladie de l’enfant qui fonde l’indemnisation, mais l’impossibilité pour la mère d’interrompre la grossesse suite à une faute médicale.
Applications concrètes
- Contaminations transfusionnelles : la charge de la preuve peut être inversée si la victime apporte des indices probants (Cass. 2005).
- Infections nosocomiales : la victime doit prouver un lien avec l’acte médical. Mais si un enchaînement fautif est démontré, la causalité juridique est reconnue (Cass. 2008).
- Handicaps à la naissance : plusieurs fautes peuvent fonder une responsabilité conjointe, même si l’origine exacte du handicap reste incertaine (Cass. 2010).
Le défaut d’information comme cause juridique autonome
Le défaut d’information n’a pas nécessairement causé le dommage, mais il a privé la victime d’une chance d’y échapper. Ce raisonnement est admis de longue date (Cass. 1990, 2010) et justifie une indemnisation partielle.
Une autonomie assumée face à la science
Dans un arrêt de 2024, la Cour de cassation a confirmé que la causalité juridique peut être présumée, même en l’absence de preuve scientifique formelle, dès lors qu’un faisceau d’indices relie le produit de santé au dommage. Cela garantit l’accès à la réparation, même lorsque la certitude scientifique est hors de portée.
✔️ En résumé
La causalité matérielle identifie ce qui s’est passé ; la causalité juridique détermine qui doit répondre. Cette distinction protège les victimes en leur permettant d’être indemnisées même lorsque la preuve scientifique est incomplète, dès lors que le lien entre faute et dommage est logiquement et juridiquement établi.
IV / Lien de causalité : les assouplissements probatoires en faveur des victimes
Le principe assoupli par la jurisprudence
En droit commun, la charge de prouver le lien de causalité entre faute et dommage incombe à la victime. Mais face aux difficultés probatoires, notamment en matière médicale ou scientifique, la jurisprudence – parfois appuyée par le législateur – a instauré des présomptions de causalité, facilitant l’accès à la réparation.
Contamination transfusionnelle : une présomption bien établie
Depuis 1995, une présomption de lien entre transfusion et contamination est reconnue si aucun autre facteur explicatif n’apparaît. La victime doit simplement présenter un faisceau d’indices cohérents. Le régime a été consolidé par la loi du 4 mars 2002, et confirmé jusqu’en 2024, y compris lorsque l’ONIAM agit en substitution : le doute profite à la victime.
Vaccinations obligatoires : une protection étendue
Le Conseil d’État admet un lien présumé entre certaines vaccinations obligatoires et des pathologies graves, même sans preuve scientifique certaine. Ce lien repose sur :
- l’état antérieur du patient,
- le délai d’apparition des symptômes,
- l’absence d’antécédents médicaux.
Depuis 2021, pour écarter la responsabilité de l’État, il faut prouver qu’aucun lien scientifique probable n’existe. La CJUE et la Cour de cassation ont validé ce recours aux présomptions sérieuses même sans consensus médical.
Infections nosocomiales : une responsabilité sans faute
Les établissements de santé répondent de plein droit des infections nosocomiales, sauf à démontrer une cause extérieure. Ce régime est en vigueur depuis la loi de 2002, et s’applique même sans faute. Le juge peut le soulever d’office. En pratique, prouver une origine étrangère à l’hospitalisation est très difficile, et le bénéfice du doute revient au patient.
Contamination VIH : preuve par présomption
En 2024, la Cour de cassation a reconnu que la contamination par le VIH pouvait être prouvée par faisceau d’indices (comportement fautif, chronologie, examens médicaux), même sans preuve virologique formelle. C’est une avancée importante en matière de protection des victimes.
✔️ En conclusion
La jurisprudence a construit une logique d’équité probatoire : dans les situations médicales complexes, l’exigence de certitude scientifique cède le pas à la vraisemblance et à la logique du vécu. Les présomptions, qu’elles soient légales ou jurisprudentielles, permettent de garantir un accès réel à la réparation, sans affaiblir la rigueur du droit.