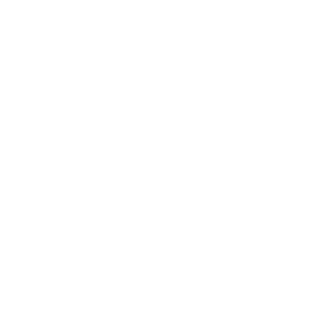Réparation du dommage corporel : principes & outils clés
Réparation du dommage corporel : principes et pratiques en droit français
L’essentiel
La réparation du dommage corporel en France repose sur trois piliers : la réparation intégrale (ni perte ni profit), l’interdiction de minoration du dommage (absence d’obligation pour la victime de “mitiger” son préjudice) et l’absence de caractère punitif (pas de punitive damages). Ces principes irriguent les évolutions récentes : passage d’une évaluation globale à une évaluation poste par poste, articulation rigoureuse avec le recours des tiers payeurs, usage de nomenclatures (Dintilhac en pratique) et de référentiels indicatifs (ONIAM, référentiel des cours d’appel), sans barémisation.
1) Le principe directeur : la réparation intégrale
La finalité est de rétablir l’équilibre détruit, sans enrichir ni appauvrir la victime. En pratique, cela suppose d’identifier chaque chef de préjudice, d’en mesurer l’étendue et d’allouer le montant correspondant — et seulement celui-ci.
La difficulté naît de l’intervention des tiers payeurs (organismes sociaux, assureurs, fonds), subrogés dans les droits de la victime : pour éviter double indemnisation d’un côté et insuffisance d’indemnisation de l’autre, le système exige une architecture de calcul précise et traçable. Ce point de friction n’altère pas la centralité de la réparation intégrale, qui demeure la boussole du contentieux.
2) Interdiction de minoration du dommage
Le droit français écarte la “mitigation” à l’anglo-saxonne :
- La victime n’a aucune obligation de se soumettre à une intervention, un transfert, une rééducation ou des traitements destinés à limiter le dommage. Le consentement aux soins fonde cette position.
- Le juge apprécie les préjudices tels qu’ils se présentent, sans décote au motif qu’une prise en charge “optimale” aurait pu, hypothétiquement, réduire le dommage.
- La logique s’étend au-delà du médical : des choix économiques post-accident discutables ne peuvent justifier une minoration. La cause du dommage demeure l’acte fautif initial ; on ne substitue pas à la réparation intégrale un devoir de “gestion idéale” par la victime.
3) Absence de caractère punitif
L’indemnisation est strictement compensatoire : elle vise la restauration patrimoniale et extrapatrimoniale, sans punir le responsable ni satisfaire une logique de vengeance.
Le débat doctrinal sur une amende civile existe (faute délibérée, faute lucrative, inassurabilité, plafonds, affectation éventuelle à un fonds), mais aucun mécanisme n’a été adopté à ce jour. Toute consécration devrait respecter des exigences constitutionnelles strictes (prévisibilité, légalité, proportionnalité). Le modèle français reste donc non punitif : “tout le dommage, rien que le dommage”.
4) De l’évaluation globale au “poste par poste”
Historiquement, les juridictions pouvaient allouer une somme globale “tous chefs confondus”. L’essor des tiers payeurs a révélé les limites de cette méthode : difficulté d’imputer rigoureusement les prestations versées, risque de double paiement ou de ponction indue sur des postes personnels.
D’où l’abandon progressif de la globalisation au profit d’une lecture analytique et structurée des préjudices, seule à même de protéger la victime et de sécuriser les recours subrogatoires.
5) Recours des tiers payeurs : la mécanique clé
Le cadre légal organise un recours subrogatoire “poste par poste” :
- Les tiers ne se remboursent que sur les indemnités correspondant aux postes qu’ils ont effectivement pris en charge ;
- Les préjudices extrapatrimoniaux personnels (déficit fonctionnel, souffrances, esthétique, agrément, sexuel, etc.) sont exclus des répétitions ;
- Pas de subrogation, pas d’imputation : une prestation sans fondement légal de recours ne peut être déduite (ex. : la PCH n’est pas imputable) ;
- Côté administratif, on déduit les prestations ayant le même objet, y compris pour l’avenir, sauf lorsqu’un texte prévoit un recours en cas de retour à meilleure fortune : dans ce cas, pas de déduction afin de préserver le mécanisme légal ultérieur.
Conséquence : traçabilité et motivation sont essentielles ; à défaut de correspondance démontrée entre prestation servie et poste indemnisé, aucune imputation n’est possible et la somme revient à la victime.
6) Nomenclatures : Dintilhac comme langage commun
La réforme de 2006, en imposant le “poste par poste”, a fait émerger la notion même de poste de préjudice.
- Judiciaire : la nomenclature Dintilhac s’est imposée en pratique (sans valeur normative, mais d’usage constant par les juridictions, avocats et experts).
- Administratif : une nomenclature propre (avis “Lagier et Guignon”, 2007) existe, mais s’est révélée moins maniable ; en pratique, Dintilhac est couramment utilisée aussi devant le juge administratif.
Dintilhac propose une cartographie fine (victime directe/indirecte ; temporaire/permanent ; patrimonial/extrapatrimonial), rendant possibles traçabilité et imputation régulière.
7) Référentiels d’indemnisation : repères, pas barèmes
La réparation intégrale impose une individualisation des montants ; on parle donc de référentiels, non de barèmes. Ils offrent des bornes indicatives pour améliorer lisibilité et prévisibilité, sans contraindre le juge.
Côté administratif : le référentiel ONIAM
Élaboré en 2005 et réactualisé (dernière mention : 2018), calé sur Dintilhac, il est largement utilisé en pratique. Les juridictions rappellent son caractère indicatif ; le juge peut, le cas échéant, allouer une enveloppe globale motivée au titre des préjudices personnels, en cohérence avec la réparation intégrale.
Côté judiciaire : le référentiel des cours d’appel
Un groupe de travail mené par le conseiller Benoît Mornet a produit un référentiel indicatif (mise à jour septembre 2020) pour lisser les montants poste par poste, sans rigidifier l’évaluation.
Le décret Datajust (27 mars 2020) a autorisé, à titre expérimental, un traitement automatisé d’arrêts pour extraire des données indemnitaires. Les acteurs redoutent une barémisation de fait ; la finalité attendue est une base descriptive améliorant l’accès à la jurisprudence, non un barème contraignant.
À retenir
- Cap : réparer tout le dommage et rien que le dommage.
- Méthode : évaluation poste par poste, traçabilité, motivation.
- Protection : pas d’obligation de soins ou de “gestion idéale” par la victime ; pas d’imputation sans subrogation légale ; préjudices personnels sanctuarisés.
- Outils : Dintilhac comme standard de fait ; référentiels (ONIAM, cours d’appel) indicatifs et non prescriptifs.
- Ligne rouge : éviter toute barémisation ; préserver l’individualisation au cœur de la réparation intégrale.